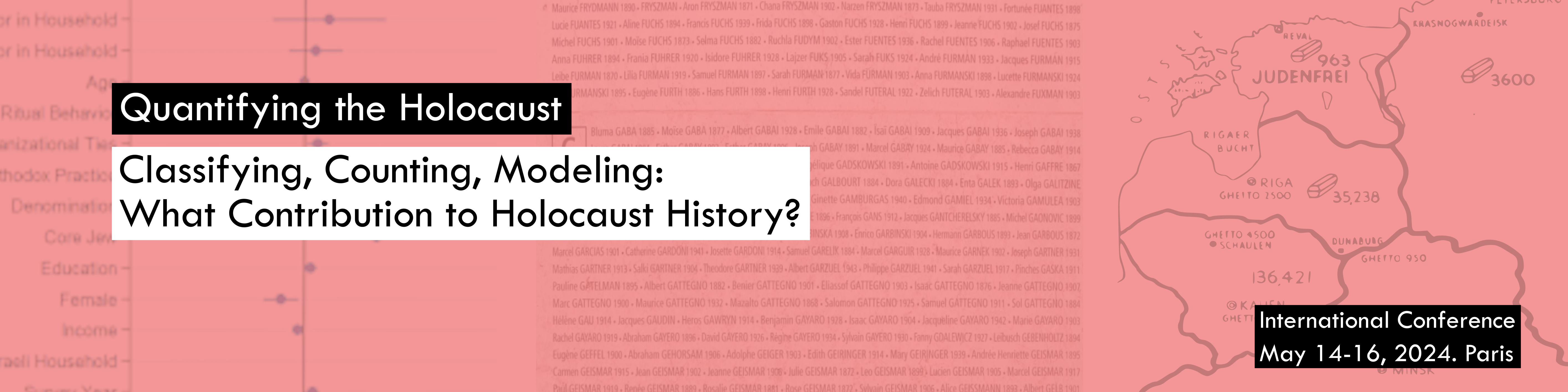
Appel à communications
Quantifier la Shoah
Classer, compter, modéliser : quelle contribution à l’histoire de la Shoah ?
Conference Internationale
Paris—14-16 mai 2024
Comité d’organisation
- Robert Braun, UC Berkeley
- Tal Bruttmann, UMR Héritages, CY Cergy-Paris Université
- Eva Kovacs, Institut Wiesenthal de Vienne pour les études sur l’Holocauste
- Maël Le Noc, Mémorial de la Shoah, Paris
- Anton Perdoncin, CNRS, Nantes Université, ERC Lubartworld
- Claire Zalc, CNRS, EHESS, ERC Lubartworld
Modalités de soumission
Nous vous invitons à soumettre des résumés de communications individuelles. Celles-ci seront regroupées par les organisateurs de la conférence dans des panels thématiques appropriés.
Nous accueillons les propositions de communication de chercheur·euse·s titulaires et non titulaires (doctorant·e·s, post-doctorant·e·s, etc.). Celles-ci peuvent être rédigées en français ou en anglais, et doivent comprendre un titre, un résumé (300 mots maximum) présentant les sources, les méthodes et les principales questions, ainsi qu’un curriculum vitae (1 page maximum).
Propositions de communication à envoyer à quantifying.holocaust2024@gmail.com avant le 26 juin 2023.
Appel à contributions
La production de chiffres est au cœur des projets de persécution et de la « solution finale ». Les recensements et les comptages liés à l’identification des Juifs font partie des mesures antisémites mises en œuvre dans toute l’Europe. La conception de la « solution finale », ainsi que sa mise en œuvre effective, s’appuient sur des chiffres. Que ce soit dans les procès-verbaux de la conférence de Wannsee, dans l’organisation des convois de déportation depuis l’Europe de l’Ouest ou dans les travaux des statisticiens SS – comme le montre le rapport Korherr du début de l’année 1943, qui estime l’évolution de la population juive depuis 1937, ainsi que les premiers effets de la politique de déportation et d’extermination –, les comptes constituent l’un des principaux sujets de discussion dans l’organisation de la persécution. Les débats historiographiques s’arc-boutent souvent sur des histoires de nombres, les estimations du nombre de Juifs représentant un enjeu politique majeur. L’assassinat lui-même s’accompagne de comptages, qu’il s’agisse des fusillades sur le front de l’Est (rapports des Einsatzgruppen, rapport Jäger, etc.), des centres de mise à mort (télégramme Höfle) ou d’autres opérations (rapport Stroop). D’autres nombres sont régulièrement utilisés dans la presse européenne, les journaux allemands ou pro-allemands publiant des listes de nombres lors des grandes phases de déportation (France à l’été 1942, Aktion Eichmann en Hongrie en 1944). Les nombres produits pendant la Shoah – arguments pour légitimer et justifier les politiques de persécution et finalement d’extermination – ont été brandis, retravaillés, parfois surévalués pour les uns, minimisés pour les autres, fantasmés pour beaucoup. Après le génocide, ces comptages ont fait l’objet de diverses utilisations, réévaluations et reconstructions – judiciaires, mémorielles, académiques – visant notamment à établir le nombre total de victimes.
Que représentent ces nombres et quels en sont les usages potentiellement ? Parce que donner un nombre c’est produire une définition qui circonscrit la chose comptée, l’étude historique des comptages soulève des questions de délimitation : qui compte-t-on, et comment ? Le processus d’agrégation des individus comptés comme exterminés soulève ainsi des questions. Que signifie compter ensemble les morts des ghettos, des fosses communes et des chambres à gaz ? Celles et ceux qui se suicident avant d’être capturés ou embarqués dans un train sont-ils et elles comptés comme des victimes ? Cela soulève également des questions de périodisation : quand le crime commence-t-il ? Par exemple, une victime des pogroms de novembre 1938 en Allemagne est-elle une victime de la Shoah ? L’identification des victimes une à une dans une démarche mémorielle, point de départ de certaines recherches historiques, est-elle pour autant toujours utile à l’historien·ne qui cherche à établir des régularités, des tendances, une vision d’ensemble du phénomène ? On dispose non de certitudes absolues – on n’aura jamais un décompte entièrement exact, car le processus même de destruction implique la dissimulation et la destruction d’indices, mais d’ordres de grandeur valables, de preuves construites.
Les comptages suscitent aussi des critiques, qu’il s’agit d’inclure dans les réflexions de ce colloque. Certains leur reprochent de reprendre scientifiquement la logique d’identification dont la population juive a été victime (on parle souvent de variable « discriminante » en statistique), ou de conforter la logique identificatrice des « persécuteurs » en regroupant un ensemble varié d’individus selon une dénomination unique (la « population juive »), contribuant ainsi à lui conférer une existence censément homogène. Ces débats sur les comptages ne sont pas spécifiques aux statistiques sur la Shoah, mais interrogent tous les processus de catégorisation et d’agrégation des individus. Ils témoignent en l’espèce du caractère complexe de ce champ historiographique, à la fois en pleine expansion et très fragmenté, chaque segment est mû par de vives controverses, aux enjeux pourtant universels mais qui se déclinent sur des thèmes ultraspécialisés – à tel point qu’il semble parfois difficile de maîtriser la bibliographie sur chacune des questions devant le foisonnement d’études localisées. Loin d’homogénéiser les populations persécutées, la classification et le comptage peuvent au contraire jeter des ponts entre différents domaines : de l’étude de la déstructuration des communautés juives à celle des politiques exterminatrices, en passant par l’analyse de l’exposition différenciée aux persécutions ou encre des incidences de long terme de la persécution sur les biographies des survivants. Comment comprendre ces chiffres ? Que pouvons-nous dire à leur sujet ? Comment les utiliser ?
Il s’agit ainsi d’examiner la fabrique des nombres pendant l’Holocauste, leur utilisation pendant les événements et leurs circulations historiques. Mais interroger la quantification de la Shoah nécessite aussi de réfléchir aux apports et aux limites des pratiques de quantification et des réflexions sur la mesure des phénomènes historiques sur le terrain particulier de l’Holocauste.
L’élaboration et la discussion des techniques d’enquête et d’analyse quantitatives percutent et renouvellent de nombreux champs de la recherche historique. Comment cela affecte-t-il les études sur la Shoah ? Ce colloque sera l’occasion de réfléchir aux potentialités et aux difficultés liées aux différents types de quantification dans ce domaine spécifique. Quantifier suppose de construire de données : comment s’opère la transformation des sources sur la Shoah en bases de données ? Que produisent ces transformations sur la compréhension de l’extermination ? Quelles sont les sources mobilisées par les chercheurs pour répondre quantitativement à quelles questions ? Au-delà des seules questions relatives aux données, le colloque ambitionne aussi d’examiner les techniques d’analyse mises en œuvre, leurs apports à la connaissance historique, ainsi que leurs limites. On s’intéressera donc non seulement aux approches quantitatives, mais aussi aux approches dites « mixtes » confrontant méthodes qualitatives et quantitatives.
C’est autour de ces différentes questions que ce colloque vise à réunir des chercheurs internationaux à Paris pendant deux jours. Le colloque sera organisé autour de trois thématiques principales articulant interrogation sur l’histoire de la mesure de la Shoah et mesure des persécutions et de l’extermination : 1/ l’histoire des nombres permettant d’entrer dans la fabrique pratique des statistiques et des comptages qui contribuent à l’appréhension ordinaire et scientifique de la Shoah ; 2/ les usages et les controverses autour de la mesure de la Shoah ; et 3/ les apports et les limites des méthodes de collecte et d’analyse de matériaux quantitatifs pour comprendre la Shoah.
1. Compter au coeur de l’extermination
Les dénombrements sont au cœur de la solution finale, à la fois comme un moyen – le comptage du nombre d’arrestations déterminait, par exemple, le nombre de trains nécessaires – et comme une fin – la quantification faisait partie du processus de mise à mort en soi. Produits par ceux qui ont conçu et organisé l’extermination – à l’instar des Sonderkommandos, qui tentent de compter le nombre de victimes dans les centres de mise à mort –, ils peuvent aussi provenir des victimes elles-mêmes, ou des témoins directs du processus d’extermination. Compter l’extermination à chaud, récolter et mettre en série des observations quantifiées des populations juives d’Europe n’est pas seulement un instrument des politiques d’extermination : c’est aussi un moyen, pendant la guerre et au cœur de l’événement, de tenter de comprendre et de documenter ce qu’il se passe pour les victimes. En témoignent les chiffres qui circulent à partir d’enquêtes dans les ghettos, comme celui de Varsovie, ou les témoignages de « témoins » (bystanders) (le journal de Sakowicz à propos de Ponary, par exemple), ou d’autres sources qui ont alimenté les articles dans la presse notamment étatsunienne, suisse ou britannique.
Comment ces chiffres ont-ils été produits ? À quoi et à qui ont-ils servi ? Quelle est leur fiabilité, et quels sont leurs pièges éventuels ? Interroger la production de statistiques dans le cadre des politiques de persécution et pendant l’extermination permet non seulement de réinterroger de façon radicale les rapports entre statistiques, domination et contrôle des populations, mais aussi de remettre sur le métier des questions importantes de l’historiographie de la Shoah : qui savait quoi ? À partir de quand l’ampleur de ce qu’il se passe est-elle perceptible et la connaissance du génocide en cours circule-t-elle, et auprès de qui ?
2. Le comptage comme instrument de connaissance de la Shoah
Dès la fin de la guerre, les comptages de victimes ont fait partie des premières tentatives pour rendre compte de la Shoah, notamment dans une perspective judiciaire. Le nombre de « six millions » de victimes s’est rapidement imposé dans les écrits des historien·ne·s après la fin de la guerre. Les efforts de Raul Hilberg pour produire des chiffres précis ont constitué un moment extrêmement important dans la délimitation de ce qu’il a nommé « la destruction des Juifs d’Europe ». L’étude de la genèse de ce chiffre et de ses usages permet de comprendre comment différents comptages ont émergé, aboutissant non pas à un nombre-étendard définitif des victimes, mais à une connaissance située du phénomène : la connaissance chiffrée de la destruction des Juifs d’Europe a sa propre histoire. Retracer la circulation des nombres – d’un moment à l’autre, d’une institution à l’autre et d’une historiographie à l’autre – invite à relire d’un jour nouveau la production de savoirs sur la Shoah depuis 1945 ainsi que les débats en son sein. Quels ont été les moyens utilisés pour compter les victimes dans l’immédiat après-guerre ? Comment divers comptages ont-ils été établis ? Par qui, dans quelles conditions, et à partir de quelles sources ? Cet axe invite à interroger les comptages dans leurs dimensions transnationales et comparatives. La comparaison entre le nombre de déportés juifs en France, en Belgique et aux Pays-Bas peut-elle être historicisée ? Quels sont les moyens d’expliquer les différences de nombres de morts d’un endroit à l’autre ?
3. Décrire et modéliser : apports et limites des analyses quantitatives
Dans la discipline historique, la quantification occupe une place particulière, liée en partie aux procédures de collecte des observations. Le passage de sources archivistiques à la construction de variables ne se fait pas sans difficultés. Celles-ci tiennent d’abord aux procédures de catégorisation, interrogeant l’essence même de la discipline historique : comment traiter chronologiquement la densité et l’épaisseur des phénomènes historiques qui résistent aux méthodes éprouvées sur des corpus de données statiques ? Elles tiennent aussi aux relations délicates entre modélisation et narration, marquées au sein de la discipline historique par une tension entre des historiographies, des temporalités et des mises en récit concurrents. Compter, quantifier, est alors une façon de lire différemment les temporalités de la Shoah, à des échelles variables, et de remettre sur le métier de l’historien·ne·la question des motifs, des rythmes et des conséquences des persécutions et de la politique d’extermination.
Le recours à des modèles économétriques a longtemps été soutenu par l’idée qu’ils fournissent non seulement des clés de compréhension du réel, mais servir aussi de base pour proposer des manières de le prédire, voire de le gouverner et de l’améliorer. Or peut-on raisonnablement réduire les choix effectués dans des circonstances tragiques aux caractéristiques sociales, démographiques ou familiales des individus qui les font ? Les quelques tentatives menées pour déterminer les facteurs des taux différentiels de survie des Juifs pendant la Shoah utilisent pour l’essentiel des techniques qui s’apparentent à ce qu’Andrew Abbott a appelé le « programme standard » de la sociologie américaine, qui modélise la causalité sous la forme de relations entre une variable « explicative » et une variable « expliquée ». Mais dans quelle mesure peut-on rendre compte d’enjeux aussi cruciaux à l’aide de variables comme le nombre d’enfants, l’âge ou le niveau de revenu ? Enfin et surtout, l’idée qu’il serait possible de prédire, voire d’améliorer, le cours des événements résonne d’une tonalité particulièrement problématique sur les terrains génocidaires : implicitement on pourrait en effet laisser croire qu’il aurait été possible d’échapper à la mécanique exterminatrice à condition si l’on avait présenté telle ou telle propriété ou, pire, si l’on avait adopté tel ou tel comportement. Les apports heuristiques des modèles sont néanmoins indéniables, en ce qu’ils objectivent le caractère différencié de la Shoah dans le temps et dans l’espace : face à la radicalisation progressive des persécutions, les compétences et les appuis sociaux permettant de s’échapper, de se cacher ou de survivre méritent d’être compris et finement pesés.
La modélisation n’est, de plus, pas la seule famille de techniques disponibles pour étudier la Shoah de manière quantitative. Les études sur la Shoah ont été touchées, comme d’autres domaines historiques, par le développement de nouvelles techniques d’analyse quantitative. Celles-ci incluent la reconstruction et l’analyse de trajectoires complexes, l’analyse formelle des réseaux, les systèmes d’information géographique et l’analyse spatiale des phénomènes de persécution, ou encore l’analyse quantifiée des témoignages au moyen de la textométrie classique ou d’outils d’intelligence artificielle (réseaux neuronaux, sémantique computationnelle). Les méthodes mixtes combinant quali- et quanti- ont également le vent en poupe. Ces développements ouvrent de nouveaux fronts de recherche prometteurs qui doivent être soumis à une discussion collective. L’une des questions est de savoir ce que leur utilisation apporte à l’analyse des processus de persécution et d’extermination et si leur utilisation peut être aisément transférée à l’étude de ces phénomènes spécifiques. Existe-t-il une spécificité du champ des recherches sur la Shoah en ce qui concerne les techniques quantitatives et les nouveaux développements techniques ? Comment ces techniques sont-elles appliquées ? Quelles sont leurs limites et leurs contributions à l’étude de la destruction des Juifs d’Europe ?

